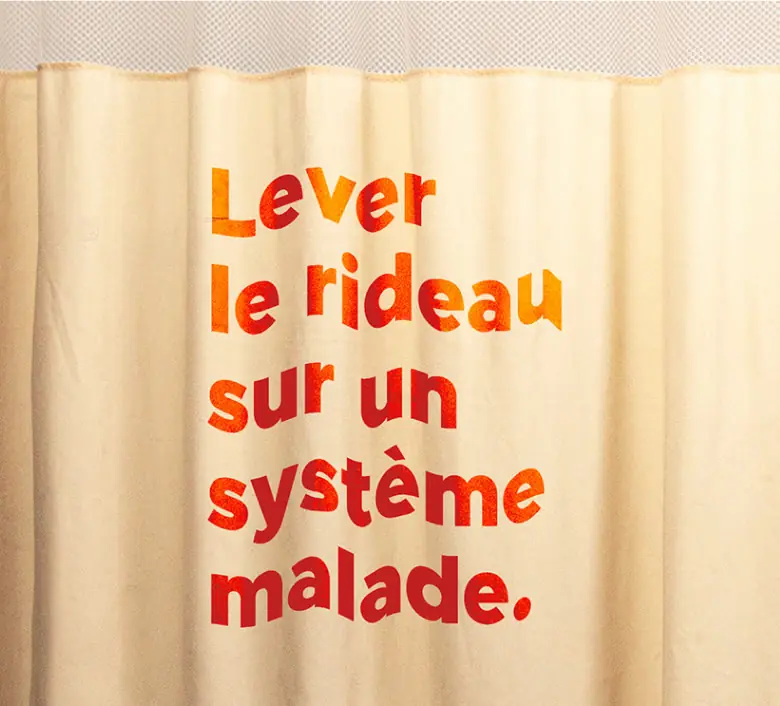Qui est
la FMSQ ?
Créée en 1965, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) regroupe les médecins des 59 spécialités médicales reconnues au Québec qui œuvrent dans le réseau de santé public. Elle regroupe plus de 36 associations médicales et 11 000 médecins spécialistes.
Sa mission : défendre et soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées qui œuvrent dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.